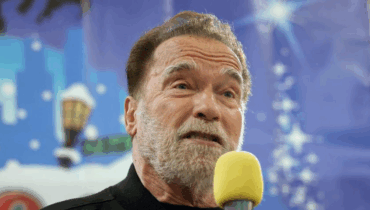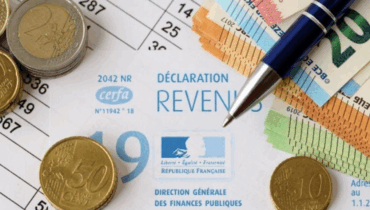« C’est l’État qui dépense pour nous »: pourquoi les Français n’ont pas mis autant d’argent de côté depuis… 1979

Publié le 17 juin 2025 par: Être Heureux
Alors que l’inflation recule et que les revenus progressent, les Français continuent pourtant de mettre massivement de l’argent de côté. Le taux d’épargne atteint un sommet inédit depuis 1979, révélant un climat d’incertitude persistant et une prudence durable, nourries par les tensions économiques et géopolitiques.
Au premier trimestre 2025, le taux d’épargne des ménages français a grimpé à 18,8 % du revenu disponible, son plus haut niveau hors période Covid depuis 1979. Ce niveau dépasse de 0,4 point celui observé fin 2024, traduisant une volonté accrue des Français de préserver leur capital, malgré des indicateurs économiques plutôt favorables. Cette dynamique surprend les analystes, qui anticipaient au contraire un retour progressif à la normale, après les pics enregistrés durant la crise sanitaire.
Le phénomène s’étend également au taux d’épargne financière – c’est-à-dire la part investie dans les actifs financiers – qui s’établit à 9,8 %, un niveau exceptionnel n’ayant pour précédent que les débuts du confinement en 2020.
Une prévision déjouée par la réalité économique
La Banque de France reconnaît avoir sous-estimé la capacité d’épargne des ménages. L’institution explique ce décalage par une hausse du revenu disponible plus importante que prévu (+12,7 % entre 2023 et 2024), tandis que la consommation n’a progressé que de 11 % et a même légèrement baissé début 2025 (-0,2 %). Résultat : l’écart entre revenus et dépenses s’est transformé en épargne.
Ce contraste, alors même que l’inflation ralentit et que le pouvoir d’achat s’améliore (+2,6 % en 2024), interroge sur les ressorts profonds de la prudence des Français.
Une méfiance enracinée dans les esprits
Le climat général explique en grande partie ce réflexe d’épargne. Selon Philippe Crevel, économiste au Cercle de l’Épargne, « le contexte économique, politique et géopolitique pousse à la retenue ». Les crises successives – pandémie, guerre en Ukraine, instabilité politique, retour de Trump – ont nourri une anxiété de fond, accentuée par les tensions sur le marché de l’emploi et l’envolée des déficits publics.
La théorie de l’équivalence ricardienne est ici mise en lumière : face à un État endetté, les ménages anticiperaient une hausse des impôts futurs, et choisissent donc d’épargner davantage. Cette logique défensive s’ancre aussi dans un vieillissement démographique : une population plus âgée pense naturellement à constituer un complément de revenu pour la retraite.
L’empreinte structurelle de l’État dans l’économie
Un autre facteur propre à la France réside dans la forte présence de l’État dans les sphères de consommation. Pour Christian Parisot, économiste chez Aurel BGC, cette délégation partielle de consommation publique – assurance maladie, éducation, sécurité – peut fausser la perception du budget disponible et renforcer l’épargne privée.
Selon lui, si les ménages devaient assurer ces dépenses de façon individuelle, une plus grande part de leurs revenus serait mobilisée, réduisant mécaniquement l’épargne. Ce phénomène souligne l’ambiguïté d’un système où l’État protège mais peut aussi freiner la consommation privée.
Une épargne à double tranchant pour l’économie
Si le gouvernement espère relancer la consommation pour stimuler la croissance, il se heurte à une prudence généralisée. Or, l’épargne n’est pas qu’un obstacle : elle est aussi un rempart. Grâce à ce « bas de laine » national, la France conserve une crédibilité sur les marchés financiers malgré une dette publique qui dérape. Philippe Crevel rappelle que « ce niveau d’épargne contribue à maintenir une bonne notation financière », contrairement aux États-Unis, où le taux d’épargne autour de 4 % fragilise la stabilité budgétaire.
Mais face à cette abondance de capitaux immobilisés, l’exécutif réfléchit à de nouveaux outils d’orientation volontaire. Un produit de placement dédié au financement de la défense a été annoncé. Pourtant, l’initiative peine à convaincre : seuls 29 % des Français se disent prêts à y souscrire, selon un sondage Ifop. Le mot « orientation » suscite la méfiance, perçu comme une mainmise étatique sur les économies privées.